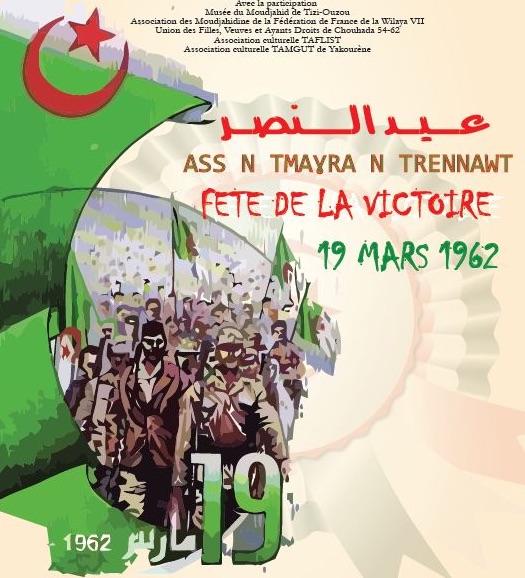L’Almanach international
Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde
25 septembre : hommage aux harkis
Depuis 2003, la France rend hommage aux combattants supplétifs de l’armée française en Algérie. C'est seulement en 2015, que furent reconnues les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France.
Les harkis sont des Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’indépendance de leur pays. Certains avaient pris en conscience le parti de la France ; d’autres n’ont pas eu vraiment eu le choix. Capturés les armes à la main, c’était la collaboration ou la mort. À la fin de la guerre, ils étaient 210 000, perçus en Algérie comme des traîtres à leur patrie et abandonné par la France le 12 mai 1962, en dépit des promesses du président De Gaulle. Finalement grâce à des désobéissance dans l’armée, 42 500 (90 000 si ont compte les familles) ont été rapatriés, les autres ont été abandonnés à leur sort, c’est-à-dire le plus souvent une exécution sommaire. En Algérie, le sujet demeure totalement tabou. Les terroristes et assassins des années 1990 ont été amnistiés, pas les harkis, qui sont toujours victimes de discriminations légales (y compris leurs enfants) et d’insultes régulières de la part des autorités.
En France, beaucoup ont passé des années, voire des décennies, dans des camps : Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), Bias (Lot-et-Garonne) ou dans les 70 hameaux de forestage dans lesquels ils travaillaient pour l’Office national des forêts. Certains vivent encore dans ces camps qui ont été établis pour eux en 1962, après les accords d’Évian.
Pendant quatre décennies, ils ont été totalement oubliés. Après une première loi de reconnaissance des services rendus en 1994, sous le président Mitterrand, Jacques Chirac a reconnu officiellement leur drame et leur sacrifice, c’était le 25 septembre 2000, date qui a été retenue ensuite pour établir une Journée nationale d’hommage aux harkis, en 2003. Une initiative qui les a laissés très insatisfaits car ils attendaient aussi la reconnaissance de l’abandon volontaire dont la majorité d’entre eux ont été l’objet, ainsi que celle de la co-responsabilité française dans les massacres de 1962-1963. Jacques Chirac avait bien reconnu la responsabilité de l’État français dans les déportations de juifs, les harkis n’en attendaient pas moins. Nicolas Sarkozy qui en avait fait la promesse en 2007, ne fera finalement rien. Il faudra attendre, la déclaration du président Hollande en 2015 : « les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France ». Lundi 20 septembre 2021, Emmanuel Macron a demandé pardon aux Harkis et à leurs enfants, annonçant un projet de loi de réparation pour ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962. Celle-ci a été votée en février 2022, juste avant le cinquantenaire du 19 mars 1962. La loi du 23 février 2022 reconnaît la responsabilité de la France dans les conditions indignes du rapatriement et de l'accueil des harkis et de leurs familles, rapatriés d'Algérie après les accords d'Évian de 1962.
La loi ouvre également un droit à réparation pour les harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage. Selon le gouvernement, 50 000 personnes pourraient bénéficier de cette indemnisation, pour un montant d'environ 310 millions d’euros sur six ans.
Aujourd’hui, les harkis et leurs descendants représenteraient entre 500 000 et 800 000 personnes en France. Des enfants et même des petits-enfants de harkis continuent de s’identifier comme tels. Leur situation reste difficile, d’autant que le terme « harki » demeure une véritable insulte dans la diaspora algérienne comme elle l’est encore en Algérie.
En avril 2024, la CDEH a condamné la France pour avoir infligé à des enfants de harkis du camp de Bias (Lot-et-Garonne) « pour traitement inhumain ou dégradants » de la fait d’avoir grandi dans un camp entourés de barbelés et de leur avoir interdit l’école de la République. Ce jugement de la Cour européenne des droits de l’homme est une première.
Des cérémonies d’hommage sont organisées dans la majorité des villes de France chaque 25 septembre.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 septembre 2024
26 mars : le jour où les Pieds-noirs ont perdu l’Algérie
Il y a 62 ans des soldats français tiraient sur la foule des manifestants faisant des dizaines de morts parmi les Européens d’Alger qui manifestaient contre l’indépendance de l’Algérie. Ce drame occulté a marqué la fin du rêve d’une Algérie française.
Il y a 62 ans des soldats français tiraient sur la foule des manifestants faisant des dizaines de morts. Les victimes de la fusillade de la rue Isly, à Alger, le 26 mars 1962, étaient des Français vivant en Algérie manifestant contre le processus de décolonisation. Quelques jours plus tôt, le 18 mars, les accords d’Évian avaient décidé un cessez-le feu en vue d’accorder son indépendance à l’Algérie, mettant fin à 17 ans d’une sale guerre qui avait débuté le 8 mai 1945. Les appelés étaient enfin démobilisés, ce que la France célèbre chaque 19 mars. Mais pour les Pieds-noirs, tel qu’on appelait à l’époque les Français vivant en Algérie, le conflit n’était pas achevé. Le Cercle Algérianiste et d’autres associations de Pieds-noirs, souhaiteraient que l’on commémore le massacre du 26 mars, et demandent que cette journée soit inscrite prochainement à l'agenda des commémorations officielles. Ce qui n’est pas le cas, il n’y a pas de commémorations récurrentes, sauf des cérémonies ponctuelles et discrètes, dans diverses localités du sud de la France où vivent de nombreux descendants de Pieds-noirs.
Cela n’a pas empêché les autorités de célébrer le 80e anniversaire du drame en présidence du président Macron qui a dénoncé «une page tragique de notre récit national» et un massacre « impardonnable ». Le président français voulait contrebalancer, dans la mémoire des Pieds-noirs, son qualificatif de « crime contre l’humanité » dont il avait taxé la colonisation, lors d’une visite à Alger en 2017. Une qualification qui n’avait pourtant rien d’exagéré si on se remémore les conditions de la conquête de 1830 et des années qui ont suivi.
Le 26 mars 2022, le président Macron avait rendu hommage aux 800 000 Français d'Algérie, «déracinés au sein de leur propre patrie», mais sans pour autant reconnaître la responsabilité de l’État français dans ce massacre. Il est vrai que les circonstances étaient assez particulières. Quelques jours plus tôt, le 23 mars déjà, des Français avaient tué des Français. Les victimes étaient des soldats du contingent tués par des terroristes français engagés dans l’OAS, la sinistre Organisation de l’armée secrète qui s’était donné pour objectif de saboter de processus d’indépendance de l’Algérie. C’est cette même OAS qui avait appelé la population européenne d’Alger à la manifestation du 26 mars. Malgré son interdiction par le préfet de police, plusieurs milliers de partisans de l'Algérie française ont afflué. Ils se dirigent vers le quartier de Bab-el-Oued, refuge de membres de l'OAS, afin de forcer les barrages installés par l'armée française Le trajet principal passe devant la Grande Poste, à l'entrée de la rue d'Isly. Des soldats du contingent, marqués par la fusillade du 20 mars, étaient chargés du maintien de l’ordre. C’est là que tout a dérapé. Un premier coup de feu est parti. On ne sait d’où, car aucune enquête officielle n’a été faite après le massacre. Soudain, les soldats ont tiré sur la foule perçue comme menaçante. Le bilan officiel est d'une cinquantaine de morts et 150 blessés, sans doute plus, on ne sait pas exactement. Des pieds-noirs se sont aussitôt vengés en lynchant des Algériens du quartier de Belcourt (aujourd’hui Belouizdad)… l’enchaînement de la violence a ruiné tout espoir d’empêcher l’indépendance de l’Algérie. C’est dire si cette date est douloureuse pour ceux qui ont dû quitter un pays où ils étaient établis parfois depuis plusieurs générations, mais établis comme colons, au détriment d’une population autochtone dépourvue de tout droit politique. L'événement a marqué le début de l'exode massif des Européens d'Algérie.
Le soir du 26 mars 1962, le président Charles de Gaulle s'adressait aux Français pour leur demander de voter en faveur de l’indépendance de l’Algérie. Il ne fit aucune allusion à ce massacre occulté pendant des dizaines d’années. En 2010, toutefois, le gouvernement français a finalement décidé d'inscrire les noms des victimes de la rue d'Isly sur le Mémorial de la guerre d'Algérie à Paris, mais l'État français n'a jamais reconnu de responsabilité dans ces événements dans lesquels les terroristes de l’OAS ont aussi leur part. D’autant qu’après le 26 mars, l’OAS fera encore de nombreuses victimes, tant civiles que militaires. L’indépendance de l’Algérie qui arrivait beaucoup trop tard, était dans le sens de l’histoire. L’opinion publique française voulait tourner la page de la guerre d’Algérie. D’où l’occultation de ce drame, comme d’autres, pendant un demi-siècle. Mais voilà que cette date du 26 mars nous revient, avec tout le refoulé sur le bon vieux temps des colonies cultivé de plus en plus ouvertement par l’extrême droite.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 mars 2024
Quelques jours plus tôt, le 23 mars 1962
12 janvier : Yennayer, le Nouvel an des Kabyles
En Algérie, chez les Kabyles, nous sommes le 1er jour de l’année 2973 du calendrier amazigh (berbère) qui débute en 950 av. J.-C., date de la victoire du roi berbère Chachnaq sur le pharaon Ramsès III. On appelle ce nouvel an Yennayer. Cette fête antérieure à l’arabisation et à l’islamisation du pays connaît aujourd’hui un net regain d’intérêt dans tout le Maghreb berbère comme dans la diaspora européenne.
Yennayer est fêté chaque année comme le nouvel an berbère. En Algérie, les Kabyles ont fini par obtenir un jour férié et chômé pour cette fête fixée le 12 janvier, même si certains mouvements chaoui, dans les Aurès préfèrent le fêter le 14 janvier. De leur côté, les Berbères marocains ont réclamé eux aussi un jour férié pour cette célébration, mais c’est la date du 13 janvier qui a été choisie, comme en Libye ou dans le Sud tunisien.
Là où il y a consensus, c’est que ce 12, 13 ou 14 janvier 2025, nous entrons dans l’année 2975 du calendrier amazing (berbère). Celui-ci est bien plus ancien que ceux des musulmans ou des chrétiens et il est également bien antérieur à l’arabisation du Maghreb. Ce calendrier débute en 950 av. J.-C., date de la victoire du roi berbère Chachnaq sur le pharaon Ramsès III. Chachnaq (sous le nom de Sheshonk 1er) est le fondateur de la 22e dynastie pharaonique d’Égypte.
Ce nouvel an berbère est appelé Yennayer (ⵢⴻⵏⴰⵢⴻⵔ), un mot dérivé de İanuarius (janvier en latin). Mais comme, en amazing, ⵢⴰⵏ (yen) est l’une des formes possibles du chiffre un, le terme s’est imposé comme appellation du Jour de l’an berbère.
Comme beaucoup de fêtes de fin ou de début d’année, Yennayer était en lien avec le solstice d’hiver et les phénomènes naturels qui marquent le renouveau. La date du Yennayer est basée sur le calendrier julien qui avait cours dans l’Antiquité. Avec le temps, un décalage s’est produit avec le calendrier grégorien qui a été adopté à l’international, sauf par quelques Églises, comme celle de Russie qui célèbre le nouvel an le 14 janvier.
La date du 12 janvier, retenue par les associations culturelles kabyles repose, en fait, sur une erreur de conversion qui n’a jamais été corrigée. Au XIXe siècle, le décalage des deux calendrier n’était que de 12 jours. Qu’importe, cette date fait aujourd’hui partie du patrimoine et de l’identité algérienne. En 2017, Yennayer a fini par être officiellement reconnu en Algérie comme « jour de fête nationale », chômée et payée. Un progrès, même s’il est encore interdit de manifester avec le drapeau berbère ! En Algérie, les autorités attachées à l’identité exclusivement arabo-musulmane du pays, ont longtemps ignoré et même rejeté, ces festivités. Cette fête du nouvel an, qui connaît aujourd’hui un net regain, est l’occasion pour une population qui se sent oubliée d’affirmer son amazighité, en Algérie, en France ou ailleurs. Chaque année, les islamistes lancent une campagne contre la célébration de Yennayer, déclarant cette fête illicite (haram) ce qui n’empêche pas cette fête de nouvel an d’être de plus en plus populaire.
« Qui célèbre yennayer éloigne le mauvais œil et les infortunes » dit un adage populaire. Aussi, ne manque-t-on pas de commencer les festivités en égorgeant un animal, généralement un coq fermier, histoire d’éloigner le malheur de la maison. Ce coq sera consommé la veille de Yennayer dans un plat unique lors d’un dîner (Imensi n’Yennayer) où la famille se retrouve au grand complet. On a pour habitude de laisser une ration et une cuillère pour l’absent quel qu’il soit, parent éloigné ou pauvre de passage. Le lendemain, on continuera à faire ripaille avec des plats traditionnels mais sans viande cette fois. S’ajoutent d’autres rites plus ou moins liés, eux aussi, à la fécondité ou à la prospérité, tel le fait de célébrer un mariage ce jour-là, de changer le mobilier de la maison pour accueillir d’heureuses nouvelles ou encore de planter des tiges de laurier-rose dans les champs de culture qui vont éloigner les parasites et garantir de bonnes récoltes.
Aseggas amimun, ameggaz, yeh’lan, ighudan, ifulkin…, Bonne année !
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 janvier 2025
Le drapeau berbère, toujours interdit d’usage en Algérie
8 mai : le « premier martyr » algérien de la guerre de libération
Le 8 mai a été décrétée Journée nationale de la Mémoire, commémorant les victimes des massacres du 8 mai 1945. Cette année, c’est la troisième édition de cette journée de mémoire.
La France et l’Algérie commémorent la même journée, celle du 8 mai 1945, mais sans se référer à la même mémoire. Trois quarts de siècle après l’événement, les blessures ne passent pas. En mai 2020, le président Tebboune annonçait une Journée nationale de la Mémoire, commémorant les victimes des massacres du 8 mai 1945. Cette année, c’est la troisième édition de cette journée de mémoire.
À Sétif (Algérie) en dépit du couvre-feu imposé à la population autochtone, quelque 10 000 Algériens défilent pour réclamer la liberté. Un drapeau algérien est brandi. Un officier de police français sort une arme vise le porteur du drapeau et le tue de 2 balles. Ce jeune scout s’appelait Bouzid Saâl, une stèle honore aujourd’hui la mémoire de ce « premier martyr de la guerre de libération ». D’autres coups de feu sont tirés sur la foule en panique faisant 35 morts. Ce ne sont que les premiers d’une journée de massacre qui décimera 10 à 20 000 Algériens du Constantinois et une centaine de colons. On est en 1945, la France fête la fin de la Seconde Guerre mondiale… et en Algérie, la guerre d’indépendance commence ce même jour. Ce 8 mai 1945 est le jour où tout a basculé. Il devenait évident pour la majorité des Algériens que dorénavant la France et l’Algérie n’aurait pas la même destinée. Les Français mettront du temps à le réaliser. Les premiers mots d’excuses à propos des morts de cette funeste journée de la part des autorités françaises ne viendront que le 8 mai 2005.
Sous le slogan « Une mémoire qui refuse l'oubli », les festivités officielles doivent se dérouler samedi à Sétif, à 300 km à l'est d'Alger. La Journée de la mémoire a été instituée par une loi adoptée à l'unanimité le 23 juin 2020 par l'Assemblée populaire nationale (APN).
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde
Déjà en 1945, la jeunesse algérienne en quête de liberté
Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee
1er novembre : la « révolution » algérienne
L’Algérie commémore sa « Révolution de novembre ». Ce jour-là en 1954, une série d’attentats coordonnée par un FLN qui faisait pour la première fois parler lui, marquait le déclenchement de la Guerre de libération nationale.
L’Algérie commémore sa « Révolution de novembre ». Ce jour-là en 1954, une série d’attentats coordonnée par un FLN qui faisait pour la première fois parler lui, symbolisait le déclenchement de la Guerre de libération nationale. Ce jour férié en Algérie est marqué par des défilés militaire et la glorification de la guerre d’indépendance.
De cette « Toussaint rouge », les Français ont surtout gardé l’image de ce jeune instituteur français qui venait prendre son premier poste dans le bled et qui fut abattu après l’attaque du bus dans lequel il voyageait. Il faudra cependant de longs mois avant que Paris ne réalise qu’une guerre avait commencé ce jour-là. L'Algérie célèbre le début officiel de sa guerre de libération, laquelle avait, en fait, débuté en 1945, le 8 mai, mais, à l’époque, peu l’avaient vraiment compris.
68 ans après cette « révolution », le régime totalement fossilisé, appuie toujours sa légitimé sur ce conflit de libération que seuls les Algériens les plus âgés ont connu. Cette année, 2022, Alger a choisi la date symbolique du 1er novembre pour abriter le 31e sommet de la Ligue arabe afin de rappeler le soutien arabe à la Révolution algérienne mais aussi marquer son retour sur la scène diplomatique. La victoire finale de cette guerre de libération qui s’est achevée en 1962 fut aussi diplomatique : elle est aussi le fruit du soutien de plusieurs pays arabes, notamment de l’Égypte, dès 1954, de l'Arabie Saoudite qui a plaidé pendant des années pour la cause algérienne devant l'ONU, mais aussi de la Syrie, du Yémen, du Liban et d’autres.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde
19 mars : hommage aux victimes de la guerre d'Algérie
La France commémore le 60e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. En 2012, cette date a été instituée “Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie” mais elle ne fait pas l’unanimité…
La France commémore le cessez-le-feu du 19 mars 1962, une célébration qui ne fait pas l’unanimité. Pour les appelés (1,2 millions) et leur famille, cela marque la fin d’un long et pénible engagement qui longtemps n’a pas eu droit à l’appellation de guerre. La date du 19 mars était célébrée depuis longtemps par les associations d’anciens combattants, mais elle n’a eu droit à une reconnaissance officielle qu’en 2012, pour le 50e anniversaire, comme Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette année pour le 60e anniversaire, l’événement est plus marqué qu’à l’ordinaire même si la guerre en Ukraine l’a relégué au second plan.
Le 19 mars comme date de l’hommage national aux morts en Algérie continue cependant à être rejetée par les représentants des « rapatriés » et des harkis. Si le 19 mars évoque la joie du retour des militaires français dans leur famille, il marque également l’amorce d’un drame pour les rapatriés, contraints au déracinement, et le début d’une tragédie pour les harkis, massacrés dans les semaines qui suivirent, au mépris des accords d’Evian. Si bien que le président Chirac avait inventé une nouvelle date d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, le 5 décembre. Mais faute du moindre fondement historique, elle est aujourd’hui peu marquée.
En Algérie, le 19 mars n’est pas férié, ce n’est que la Fête de la victoire (النصر). La vraie fête d’indépendance est le 5 juillet (date sa proclamation en 1962 et anniversaire du début de l’occupation du pays par les Français, le 5 juillet 1830). Avec le Hirak, beaucoup en Algérie rêvaient d’un seconde libération (une seconde indépendance pour certains !), et sont aujourd’hui très déçus que le mouvement se soit enrayé. Le système politique algérien, sclérosé et corrompu, est accusé par la majeure partie de la population d’avoir confisqué la victoire et l’indépendance au profit d’une petite élite.
A Paris, une cérémonie débute 16h30 au mémorial du quai Jacques Chirac qui a été complètement transformé pour l’occasion (remise de décorations, discours de la ministre déléguée aux Armées et dépôt de gerbes) - La cérémonie à l’Arc de Triomphe est à 18h30 (dépôt de gerbes et ravivage de la flamme).
Le 19 mars est dédié aux victimes du conflit : 30 à 35 000 Français (dont 25 000 militaires et 6 à 10 000 civils, ces derniers, en majorité tués après le 19 mars), 350 à 400 000 Algériens selon les historiens (et non un millions et demi d’après le discours officiel) quand aux harkis, les supplétifs algériens de l’armée française, la fourchette pour eux est encore plus large : de 30 à 150 000, selon les sources, et en comptants les règlement de compte après le 19 mars.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 mars 2025